Coco et les belles anglaises
Par Jean de la Marck

Coco, c'est mon père. Ce surnom lui a été donné par ses collègues de la police de Liège. Pourquoi ? Je n'en sais trop rien. Allez savoir ? Sans doute pour plusieurs bonnes raisons. Mon père était un homme charmant, convivial, blagueur, toujours de bonne humeur, sifflotant en travaillant, casse-cou au guidon d'une moto, l'œil pétillant lorsqu'il posait un regard approbateur sur l'éternel féminin. Tout ceci pourrait expliquer son surnom. N'oublions pas qu'à la police on a du flair et que l'on connaît vite les mérites ou les défauts de tout un chacun.
Tout jeune, mon père a été pris de passion pour les motos, Motos antédiluviennes peu en rapport avec les rutilantes japonaises et américaines que l'on voit circuler à présent sur nos routes. À chacun son époque. Lui, à seize ans, il caracolait sur des engins qui feraient se bidonner les jeunes de maintenant. Imaginez, une mécanique haute sur pattes, équipée de pneus très fins, d'un large guidon sur lequel sont fixées toute une série de petites manettes : une pour régler les gaz, une pour l'avance à l'allumage, une pour l'admission d'air, une lampe ou lanterne à acétylène pour circuler la nuit. Pour s'asseoir, une large selle, genre vélo ; montée sur ressorts à boudins. Un sélecteur de vitesses, à main, placé sur le côté droit d'un petit réservoir à essence, obligeant le pilote à lâcher le guidon de la main droite afin de pouvoir changer les rapports de vitesse. La transmission du moteur vers la roue arrière se faisait, non pas par une chaîne, mais par une courroie. Quant à la suspension, n'en parlons pas, elle était aux abonnées absentes. Voilà la moto sur laquelle mon paternel a fait ses premiers tours de roue. Non sans casse bien entendu. Il m'est revenu aux oreilles, lors de discussions dans la famille, qu'un jour , s'étant rendu en balade à Waremme, chemin faisant, il était tombé une dizaine de fois , tant le maintien en équilibre sur les gros pavés « tête de mort » était instable. C'est amour de la moto, il l'a conservé jusqu'à sa mort.
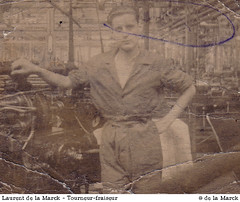
À seize ans, après avoir fait des études à l'école de mécanique du quai du Condroz, il entre en apprentissage à la fabrique des motos Gillet installée à Herstal. Ensuite gravissant quelques échelons, il travaille comme ajusteur-tourneur aux Ateliers Gamin de la rue Grétry. Pendant tout ce temps, il ne cesse de rouler sur la moto de son beau-frère, mari de sa sœur Jeanne. Vint alors la grande crise économique de 1936 ainsi que des bruits alarmants en provenance de l'Allemagne. En 1939, lors de l'Exposition Internationale de l'Eau réalisée à Lège, il quitte les Ateliers Gamin pour entrer à la Police. Pourquoi ce changement me direz-vous ? Pour quelqu'un passionné de mécanique ! La raison est à trouver dans la situation économique de l'époque. Beaucoup de grèves, des emplois précaires, ont influencé mon père à prendre une autre orientation afin de se garantir un emploi stable tout en sachant bien qu'il perdait 200 francs (de l'époque) par mois. Son salaire chez Gamin était, si mes souvenirs sont bons, d'environ 1100 francs alors qu'à la police il débutait à 900 francs.

En 1940, nous entrons dans la période noire de la guerre. Coco est mobilisé et participe à la campagne, dite des 18 jours, comme estafette motocycliste. Il ne fera pas les 18 jours de guerre, car il sera vite fait prisonnier avec son unité. On le retrouve parqué dans un camp, du côté de Roulers, avant un départ en déportation vers les camps allemands. Rongeant son frein, il est bien décidé à ne pas rester sur place et ne pas se faire embarquer les bras ballants. Aussi, il échafaude divers plans d'évasion. La moto, bien entendu, vient à son secours. Près du camp, les allemands ont entreposé un nombre impressionnant d'engins de toutes sortes, parmi lesquels des motos. Coco les aperçoit, les lorgne, s'en approche discrètement, les renifle, il les touche mine de rien. Il constate qu'une moto est en ordre de marche, plein d'essence fait. Sans hésitation, il l'empoigne, s'élance en courant à côté, le moteur démarre, il saute dessus, met les gaz à fond, se couche en s'aplatissant le plus possible, car, les allemands ayant décelé le manège commence à lui tirer dessus. Sans se retourner Coco fonce plein pot droit devant lui. Quelques kilomètres plus loin, il s'arrête dans une ferme. On lui procure des habits civils. Il remonte sur la moto et, dans la confusion générale existant sur les routes, se fraye un chemin et rallie la Cité Ardente. Vous comprendrez notre joie, ma mère et moi en revoyant notre Coco sain et sauf. Très vite, il a fait disparaître la moto en la démontant complétement afin de la revendre en pièces détachées.
Revenu à la vie civile et n'étant pas déserteur, il réintègre les services de la police pour être affecté à la 1ère Division dont le territoire opérationnel se situe en plein centre de la ville. À cette époque, je me souviens, certains soirs, quand il mettait son uniforme pour aller effectuer des patrouilles nocturnes, je le trouvais à la fois impressionnant et débonnaire avec son casque d'acier de couleur blanche, la pèlerine posée sur la tunique, attachée au cou par une sorte de petite agrafe surmontée d'une tête de lion, le pantalon, type cavalier avec les jambes enfouies dans de grandes bottes bien cirées. Le voyant ainsi, prêt à partir en mission, il me faisait penser à cette chanson de Maurice Chevalier dont le refrain était « Les agents sont des braves gens qui s'baladent, qui s'baladent ; les agents sont des braves gens qui s'baladent tout le temps. « Et pourtant les patrouilles nocturnes n'étaient pas des parties de plaisirs. Il faisait noir, les rues étaient désertes, et les rencontres avec les patrouilles allemandes se faisaient sans grande chaleur. En plus, il y avait la hantise d'arriver à temps aux différents points de contrôles effectués par un inspecteur pointilleux.
En 1942, nous habitions rue de la Cathédrale, dans un immeuble où étaient installés un agent de change et un coiffeur pour hommes. À cette époque, Coco, toujours mécanicien dans l'âme, s'était aménagé dans la cour de la maison familiale, située Montagne Sainte-Walburge, un atelier, certes peu confortable, mais bien équipé en outillage. Bien entendu il n'était pas question de s'occuper de motos, elles étaient devenues une denrée rare. Ne restant pas inactif pour la cause, il commença par réparer et monter de solides vélos pour le compte de quelques commerçants du centre-ville en panne de moyens de locomotion pour fournir la clientèle. C'est à ce moment qu'il fut transféré à la brigade de la sûreté troquant son uniforme pour des habits civils. Tâche très délicate que le rôle d'inspecteur de la sûreté en ces temps si troublés. En effet, lors d'enquêtes, il n'était pas rare de se voir confronter à des problèmes épineux tels que se demander si parfois l'on avait affaire à des faits de résistance ou de banditisme. Comme il était membre d'un mouvement de résistance, il était bien placé pour juger s'il fallait arranger « les bidons » en cas de nécessité. Par exemple, il lui est arrivé, au cours de certaines missions dans le « gross Luttich » (Grand Liège voulu par les autorités allemandes) de convoyer des personnes vers l'extérieur de la ville, du côté des bois du Sart-Tilman sur le tracé de la future route du Condroz. Ma mère et moi n'étions pas au courant de ses activités de résistance. Parfois, on recevait du courrier sous forme d'une carte postale, genre touristique, expédiée de Laroche sur laquelle on pouvait lire un message mystérieux tel que « Les marcassins vous saluent bien ». Coco, lui, en connaissait la signification.
En, 1944, ce fût enfin la délivrance tant attendue, la fuite éperdue des troupes allemandes, et la période glorieuse de la Libération. Dès ce moment ; la police reconstitue un service du roulage avec de l'équipement reçu de l'armée américaine (Jeep) et de l'armée anglaise (motos). C'est ainsi que mon père se retrouve une fois de plus à troquer ses vêtements civils pour une salopette et une tenue de motard. Comme mécanicien, il est désigné pour s'occuper de l'entretien et des réparations des motos dans un garage situé rue Saint-Pierre, tout en restant policier motard et participer à certaines manifestations, telles qu'escorter des personnalités ou accompagner des défilés. À cette époque, il n'y avait pas de barrières Nadar, aussi, était-il nécessaire de canaliser la foule. Pour contenir les gens massés sur les trottoirs et qui empiétaient le plus souvent sur la chaussée, rétrécissant de ce fait le passage des cortèges, il était nécessaire de faire appel aux motards de la police afin de faire reculer la foule. Le travail consistait à remonter les chaussées en aval des cortèges. Cela se faisait à grande vitesse en rasant les pieds des personnes. À ce petit jeu, coco était un crack. À de nombreuses reprises, présent comme spectateur, il m'est arrivé d'entendre, avec une certaine pointe de fierté, des personnes l'invectiver après un frôlement un trop forcé. C'était du genre « asse veyou cilà, i m'a cozî k'bouté djus. ». Bien entendu, moi je riais sous cape.
Au garage de la rue Saint Pierre, il bichonnait ses petites anglaises. C'étaient des Triumph 350cc dites de récupération de l'armée anglaise. Il s'agissait de motos provenant d'un surplus de fabrication pour l'effort de guerre et qui n'avaient plus d'affectation. Ces motos étaient livrées avec leur peinture kaki. Il était donc nécessaire de les rendre conformes aux normes de la police quant à leur équipement. Dans un premier temps, elles étaient même dépourvues de phare. Repeintes avec un réservoir gris argent, des garde-boue noirs, des flancs de pneus blancs, elles avaient fière allure. Coco était ravi, que dis-je aux anges ! Pour son usage personnel il était parvenu à acquérir une Triump 350 cc et une Norton 500cc. Il roulait surtout sur la Triumph. Lorsque l'on partait en balade, il me prenait en croupe sur un petit siège rectangulaire fixé sur le garde-boue arrière. Quant à la Norton, elle sortait aux grandes occasions. C'était presque une moto d'apparat tant elle était jolie et racée. Avec son réservoir noir et argent, ses garde-boue chromés, elle avait fière allure.
Coco avait une foule de copains, tous mordus de la moto. C'est ainsi qu'à chaque pause dîner de midi, ils arrivaient à la maison presque tous en même temps. C'était alors un défilé de belles anglaises aux noms magiques : AJS, BSA, ARIEL, MATCHLESS, ROYAL ENFIELD, TRIUMPH. Elles venaient toutes se faire règles les soupapes, changer les vis platinées, remplacer un câble à gaz. Bref, se confier à des mains expertes. Que du bonheur pour Coco qui effectuait tous ces travaux assis sur la bordure du trottoir, en face de la maison. Il travaillait ainsi en noir, ou en black si vous préférez une appellation actuelle, au vu et au su de tout le monde. Je me suis toujours demandé comment il parvenait à rester calme et concentrer sur son travail. Autour de lui, les propriétaires des machines discutaient ferme sur les performances, les cylindrées, les reprises en troisième, les dépassements, etc. Nous les gamins on écoutait attentivement en attendant impatiemment que Coco ait terminé ses réglages afin de pouvoir faire un petit tour d'essai. C'était alors un moment de délectation. Plaqué contre le dos de Coco, on savourait la griserie de la vitesse en grimpant plein pot la Montagne Sainte-Walburge. Lorsque revenu au point de départ, on descendait du pur-sang, on avait les cheveux ébouriffés et les jambes flageolantes. Oufti qué plêzir.

Dans sa petite clientèle, il y avait parfois, comme dans toute clientèle, de drôles de spécimens : le jamais content du réglage, le maniaque du bruit de soupapes, le fêlé des reprises. Pour d'autres, tout baignait dans l'huile. Prenons le cas de « Donné », un vieux de la vieille. Il possédait une splendide Triumph 5OO cc bi-cylindre montée avec side-car. Pour lui, peu lui importait le montant des entretiens ou des réparations, pour autant qu'il puisse mettre en marche, le moteur, au premier coup de « kick » (levier permettant la mise en marche au moyen du pied). Il avait été gazé à la guerre 14/18 et il ne pouvait pas se permettre de « kicker » à plusieurs reprises sous peine d'étouffement. Il est arrivé que « Donné » prête sa machine complaisamment à Coco, lorsque celui-ci devait se rendre à Blankenbergh, pour les vacances d'été, en compagnie de ma mère et du chien Vicky, un magnifique boxer. Je ne vous dis pas l'épopée ! Départ à 7 heures du matin, ma mère, imposante personne, se casant tant bien que mal dans le side-car qui n'était pas loin de là un royal-class, venant ensuite, l'introduction avec beaucoup de réticence du boxer. Celui-ci s'étalant sur les jambes de ma mère, la gueule reposant sur son ventre. De ce temps-là, les autoroutes n'existaient pas. Il fallait bien emprunter les routes nationales et passer par les grandes villes que sont Louvain, Bruxelles, Gand et Bruges. En tirant bien cela faisait presque 5 heures de route, en comptant les petits arrêts pipi. Arrivés à bon port, ils étaient cassés. Pour Coco cela ne se passait pas trop mal. Mais pour ce qui concernait maman Jeanne, ces premières paroles furent : jamais plus ! Il aurait presque été nécessaire d'avoir un palan pour la sortir du siège tant elle était recroquevillée. Son corps raidi par les heures de route avait pris la forme du siège. Quant au chien, la langue pendante, il se demandait dans quelle galère il avait ramé.
Un autre « client » possédant également une Triumph side-car était sourd comme un pot. Il arrivait à la maison et demandait à Coco de régler le moteur parce qu'il lui semblait qu'il y avait trop d'avance à l'allumage. Après vérification, Coco devait bien constater qu'il avait raison, et lui demandant comment il savait que son moteur ne tournait pas rond. Par gestes, il faisait comprendre qu'en mordant dans la poignée des gaz, il ressentait des vibrations contraires.
Un jour, une sorte de dandy, style zazou (en rapport avec une mode très en vigueur chez les jeunes vers la fin de la guerre) vient trouver Coco de la part d'un ami de ses amis. Voilà dit-il ce qui m'amène auprès de vous ; figurez-vous que je viens de faire l'acquisition d'une moto anglaise de la marque VINCENT H.R.D. Surpris, mon père lui fait remarquer que ce n'est pas une moto pour la route. En fait, il s'agit d'une moto conçue pour battre des records de vitesse, genre kilomètre lancé ou kilomètre départ arrêté sur des portions d'autoroute. Oui, je sais dit Zazou, surnom que Coco venait de l'affubler au vu de son accoutrement, seulement voilà, lorsque je l'ai entrevue, j'ai eu un coup de cœur et voilà pourquoi je me suis payé cette petite folie. Autre chose dit-il à mon père, la moto est en pièces détachées, bien rangées dans deux caisses. Car, figurez-vous que j'ai acheté cette moto bien entière, mais ne parvenant pas à la mettre en marche, j'ai demandé à un copain s'y connaissant un peu en mécanique de bien vouloir y jeter un petit coup d'œil. Sitôt dit sitôt fait, voilà la machine toute démontée et le copain, perplexe devant tant de pièces a été incapable de la remonter convenablement. Aussi dit Zazou voulez-vous bien trouver une solution à mon problème. Seriez-vous d'accord de la remettre en ordre. Je paierai ce qu'il faut. Mon père se gratte le sommet du crâne, réfléchi, hésite puis se décide à relever ce sacré défi. C'est pas tous les jours que l'on peut avoir une mécanique aussi prestigieuse entre les doigts. Zazou amène donc les deux caisses ainsi que le châssis et les roues. Tout le matériel est descendu dans l'atelier de Coco. Pendant deux semaines, chaque soirée sera consacrée à vérifier, aléser, nettoyer chaque pièce puis procéder au montage du moteur, tout cela en sifflotant tant il était content de la tâche qu'il accomplissait. Enfin le grand jour est arrivé. La moto est entièrement reconstituée. Il est temps de procéder à un premier essai. Avant tout il faut la sortir de la cave-atelier, ce qui n'est pas une mince affaire compte tenu du poids de la machine. Tant bien que mal, avec quelques copains, nous aidons Coco à la hisser au moyen de cordes et beaucoup d'énergie afin de la déposer sur le trottoir. Tout de suite elle suscite la curiosité des passants. Dame, ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'approcher un tel engin. Longue, basse, de couleur noire, elle ressemble à une panthère prête à bondir sur sa proie. Elle fait peur et, ce ne sont pas les deux tromblons qui terminent l'échappement des gaz qui sécurisent. Pourtant il va bien falloir la mettre en route. Si je me souviens bien, une grosse difficulté pour la faire démarrer était qu'elle était dépourvue d'un « kick » de lancement. En effet, comme il s'agissait d'une moto de compétition, le démarrage s'opérait en courant à côté puis en sautant en amazone avant de se mettre à califourchon dessus. Exercice assez périlleux, il faut bien en convenir, sauf pour Coco, qui en avait l'habitude. Pour l'anecdote, certains de ses copains voulant s'essayer à ce genre de pratique ont pris des billets de parterre avec leur moto encastrée dans la paroi de la vespasienne située au-dessus des escaliers menant de la rue des Anglais à la Montagne Sainte-Walburge.

Bref, loin de penser à tout cela, mon père empoigne la « bête » par le guidon, débraye, enclenche une vitesse, une petite pression sur le carburateur pour amener de l'essence et le voilà qu'il s'élance en mettant un peu de gaz à la poignée, il court un instant avec force, saute sur le siège et alors…. miracle, le moteur prend dans un rugissement infernal accentué par l'échappement libre. Un petit arrêt, quelques coups de gaz pour chauffer le moteur, prend une position couchée sur la longue selle, puis, c'est le départ comme un boulet de canon. Le temps de dire « oufti » il est déjà dans le grand virage au-dessus de la Montagne Sainte-Walburge. Certains riverains, aux fenêtres, n'en croient pas leurs yeux. Déjà il descend vers nous au ralenti, le moteur ronronnant comme un gros chat. Nous avons envie de l'applaudir, comme s'il venait de réaliser un exploit. Après tout cela en est peut-être un ! Zazou est heureux, content, mais il est tracassé. Après avoir assisté à la démonstration de Coco, comment va-t-il pouvoir rouler sur route avec cet engin démentiel ?
Une autre fois, à midi, nous mangeons Coco et moi, notre petite tartine de sempiternel pâté de foie de chez « Torine ». La sonnette retentit. Coco se lève, se dirige vers la fenêtre, ouvre et là, il reste bouche bée, interdit, stupéfait, n'en croyant pas ses yeux. Je me dis, ce n'est pas possible, il est devant une apparition. En fait c'en est une. Là sur le trottoir, bien rangée, dressée sur son support d'arrêt, trône une moto d'un autre âge. À peu de choses près la réplique sur laquelle mon père avait fait son apprentissage. Coco est vite descendu pour l'admirer. Son propriétaire avait l'air d'en être très fier, il la trouvait belle avec sa peinture bleue et le petit bouquet de fleurs peint sur le coffret de dépannage fixé sur le réservoir à essence. La selle montée sur de gros ressorts boudins était en cuir jaune. La transmission du moteur vers la roue arrière se faisait toujours par courroie. Modernité oblige, l'éclairage fonctionnait à l'électricité. Mes yeux faisaient un va-et-vient entre la moto et le monsieur. Je me l'imaginais « so british » : casquette en laine, lunettes en cuir, fine moustache légèrement rousse, veste trois-quarts en tweed, pantalon golf avec de grands bas torsadés. Revenu sur terre, je l'entends demander à mon père s'il pouvait se charger de l'entretien de sa machine. Mon père accepta de bon cœur, tout en se posant la question de savoir si des pièces de rechange existaient toujours. À chaque fois que notre « british » se présentait pour un réglage ou un entretien, mon père et moi on riait sous cape, car, à chaque fois qu'il s'asseyait sur sa machine, invariablement il disait « qu'elle est belle n'est-ce pas ».
Vint alors l'épisode TRICAR de mon oncle Louis. Il faut savoir qu'à l'époque dont je vais vous parler, mon oncle possédait deux charrettes et un cheval. Les mardis, jeudis et samedis il était marchand de légumes ambulant avec une des charrettes prévues à cet effet. Les autres jours il effectuait ce qu'il appelait des « chemins de charbon ». Avec l'autre charrette, équipée d'un système permettant de basculer le charbon, il se rendait dans les différents charbonnages de la région muni de bons de charbon délivrés, comme prime, aux mineurs. Son travail consistait donc, moyennant paiement, à acheminer le quota de charbon au domicile de chacun d'eux. Au fil du temps, mon oncle se rendait compte que son cheval devenant de plus en plus vieux éprouvait des difficultés pour tirer de lourdes charges. Que faire ! Mon oncle n'avait pas les moyens de se payer un camion. Un jour, une personne lui proposa un TRICAR. C'était une ancienne grosse moto de marque FN se 12OO cc qui équipait l'armée belge avant la guerre. Un engin assez imposant, avec une partie avant : roue, guidon, moteur, siège, plus un auvent de protection qui surmontait le pilote, et une partie arrière équipée d'un caisson reposant sur les deux roues. Le TRICAR avait la particularité de posséder une marche arrière, ce qui était un atout indéniable pour la fonction à laquelle mon oncle le destinait. C'est ainsi que mon oncle put continuer ses chemins de charbon en équipant le TRICAR d'un caisson basculant pour lui permettre de vider le charbon dans les caves. Bien entendu, mon père devint le mécano attitre de mon oncle. C'était un spectacle de voir et entendre arriver mon oncle juché sur son engin. Vêtu d'une veste en cuir, sa tête couverte d'un bonnet en cuir avec deux pattes qui pendaient du côté de chaque oreille et flottaient au gré du vent comme des oreilles de cocker, le visage noir de charbon, on aurait pu le prendre pour un pilote kamikaze. À chacune de ses apparitions pétaradantes, mon père restait pantois devant tant de dextérité. Car conduire, chargée de charbon, une telle machine n'était pas une sinécure.
Comme il s'agissait de son outil de travail, et pour ne pas rester en carafe lors d'une panne assez conséquente, mon père lui avait conseillé d'acheter un moteur de rechange, révisé complètement par Coco comme de bien entendu. C'est ainsi qu'ils mirent sur pied la formule de l'échange standard. Échange qui se serait opéré au garage Bourguignon, situé dans le bas de la Montagne Sainte-Walburge et dont le patron Fernand était un copain de mon père. Mais le moteur de ce TRICAR FN, était tellement costaud que je n'ai pas souvenance d'un quelconque changement. Après bien des services rendus, mon oncle l'a finalement troqué contre un camion.
Pendant ce temps, le garage de la rue St Pierre était devenu trop exigu pour un nombre de véhicules toujours croissant. Le Service du Roulage déposa donc ses pénates dans un tout nouveau garage/atelier situé rue de Vottem sur les hauteurs de Sainte-Walburge. Là, il disposait d'un emplacement pour ranger et entretenir de nouveaux combis Volkswagen. Pour ses motos, Coco disposait aussi d'un grand atelier équipé d'un banc sur lequel il pouvait monter les motos à réparer. C'est à ce moment, en 1949, que réapparurent les Herstaliennes : GILLET, FN et SAROLEA, des motos bien de chez nous. Les TRIUMPH avaient fait leur temps, il était normal et nécessaire de les remplacer par du nouveau matériel.
C'est ainsi que le groupe de motards fût équipé de 5 SAROLEA et de 4 FN, aussi rutilantes les unes que les autres. Pas à dire, nos jeunes motards avaient fière allure tout de cuir vêtus, bien campés sur leurs nouvelles montures.

Devant le nombre croissant d'entretiens et de réparations, Coco abandonna l'uniforme (malgré tout occasionnel) pour enfiler journellement une salopette et visser son béret alpin sur la tête. Toujours présent, toujours souriant, fort de ses expériences, il donnait de nombreux conseils à ses jeunes collègues. Parfois, lorsque l'un d'entre eux commettait une petite gaffe, vite il montait au garage, pour que Coco intervienne vite fait bien fait, ni vu ni connu. Comme « punition » et « prix de la réparation », Coco réclamait deux « bouquettes » de chez Blanche (petite « friture » installée à l'angle des rues de Vottem et Sainte-Walburge). Lorsque la réparation était plus conséquente que prévu, il n'était pas rare de voir Coco travailler, après les heures normales de service, afin que la moto du jeune collègue soit prête pour le lendemain matin. Je crois que beaucoup d'entre eux ont conservé de bons souvenirs de la façon toute paternelle qu'avait mon père pour arranger les « bidons ».
Après avoir vendu la TRIUMPH et la NORTON, Coco fit l'acquisition d'une superbe SAROLEA 650 cc, monocylindre, un véritable monstre de compression. Il fallait la pression d'une patte d'éléphant pour exercer une poussée sur le kick. Pour les non-initiés, un retour de kick pouvait fracturer le pied. Aussi pour la mise en marche, Coco faisait preuve de beaucoup de doigté, une petite injection au carburateur, un petit coup sur la poignée de gaz, puis un bon coup de kick du pied gauche et le moteur vrombissait. Souvent, il courait et sautait en amazone à la façon des coureurs de grands prix de vitesse.
Au vu de ce qui précède, on serait tenté de croire que Coco ne vivait que pour la mécanique et les motos. Il n'y aurait rien de plus faux, car il vivait plusieurs passions : le moto-cross et les grands prix de vitesse moto, le cinéma, américain surtout, et le football comme supporter acharné du Royal Football Club Liégeois.
A tout seigneur tout honneur, commençons par le moto-cross. De 1946 à 1948 Coco et moi, en équipe bien soudée, avons écumé les épreuves de moto-cross de la région. Au grand dam de ma mère, presque tous les dimanches de l'été nous étions sur les circuits qui portaient les noms mythiques de l'époque tels : Les Houlpaix (Jupille, près de la Brasserie Piedboeuf ), les Cahottes (Engis – Les Awirs) le Val Fassotte (Dison) ; La Citadelle de Namur, etc. Bref, en ce temps là, le moto-cross était très populaire et chaque petite entité autours de Lège se faisait un point d'honneur d'en organiser un. Y participaient de nombreux pilotes du crû ainsi que des vedettes patentées, véritables crack de valeur internationale tels que : Minguels, Meunier, Jansen, Leloup, Frenay, Pairiot, Cox, Pé, Guilly et j'en passe et j'en passe, qui ont suscité de nombreuses vocations perpétuées jusqu'à nos jours et qui font dans ce domaine la réputation de la Belgique.

s'occupant de ses canaris
Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la coupe du Journal la Meuse. Début avril elle ouvrait la saison de moto-cross et se déroulait à Spa. Elle se déroulait pendant une journée et comportait trois épreuves : une de vitesse (1 km départ arrêté), une de trial et enfin le moto-cross. Tôt le matin, avec Coco nous prenions la direction de la perle des Ardennes en caracolant, parfois dans le brouillard, sur les crêtes ardennaises. À cette époque, il n'y avait pas d'autoroute, nous empruntions la route nationale traversant les patelins d'Embourg, Beaufays, Les Forges, Mont-Theux, Franchimont pour enfin arriver au parc des 7 heures où nous laissions la moto au parking. De là, nous rendions, à pied au pied de la côte de la Sauvenière où avait lieu le départ de la première épreuve de la journée, c'est-à-dire la course de vitesse qui pour chaque concurrent se terminait par un freinage à mort avant d'entamer le passage d'une chicane debout sur les repose-pieds et dans laquelle le pilote, au risque d'être pénalisé, ne pouvait poser un pied à terre. Ensuite, c'était l'entrée dans les bois, pour effectuer le parcours trial (course d'obstacles) avec le passage du fameux gué des Artistes.
À la fin de cette matinée déjà bien remplie, nous descendions au centre de Spa afin de nous sustenter d'un steak-frites-salade dans un petit restaurant situé près du pont du chemin de fer, rendez-vous de tous les motards.
L'après-midi, après s'être restaurés, nous nous dirigions vers le parc de la Fraineuse pour assister au moto-cross, dernière compétition de la journée. C'était la cerise sur le gâteau. Quand tout était terminé, vu l'affluence et pour éviter des embouteillages, déjà à l'époque, nous reprenions la route sans connaître le vainqueur de la coupe. C'est seulement le lundi matin que le journal La Meuse dévoilait avec force et photos le palmarès de l'épreuve.
Les années 46, 47, 48, furent pour moi une période heureuse de mon adolescence et de grande complicité avec mon père. Bien que cela ne me soit apparu évident que bien des années plus tard. Par la suite les sorties du dimanche avec les copains et les copines ont pris le pas sur les escapades motorisées avec Coco. Sauf une fois ou deux où nous rendions, début juillet, au grand prix de vitesse pure sur le circuit de Francorchamps pour vibrer aux exploits de kamikazes qui avaient noms : DUKE, WITHWORTH, AGOSTINI, CAMPBELL, sur leurs Norton, Mondial, Agusta, Vélocette, sans oublier le légendaire tandem belge de side-cristes qu'étaient Vandersckrik-Siva.
Pour ce qui en était du cinéma, il était un spectateur acharné des grandes productions américaines. Il était vraiment sous le charme des comédies musicales, des grands westerns, des films de guerre. Mis à part « le quai des Orfèvres » avec Louis Jouvet, le cinéma français ne trouvait grâce à ses yeux. Il le trouvait insipide, manquant de mouvement contrairement aux grandes fresques américaines. Il se rendait au cinéma, au moins trois fois par semaine. Pour l'anecdote, vers les années 58/59, son jour de congé étant le lundi, il se pointait déjà à 10 heures de matin pour la première séance du cinéma le Crosly, situé Boulevard de la Sauvenière. Il garait sa voiture, devant l'entrée du cinéma, en stationnement interdit comme il se doit. Aussi, chaque mardi matin, un PV circonstancié, lui était adressé au garage de la police, lui enjoignant de bien vouloir offrir aux collègues verbalisant : deux bouquettes, un canard à la crème, et trois cafés. Après le Crosly, il se dirigeait, au gré des programmes vers le Forum, le Palace, dans le Pont d'Avroy, le Normandie, en Pont d'Île, jamais au Marivaux en Vinâve d'Île où l'on ne jouait que des films français. Après 3 ou 4 séances de projection, repu et satisfait il rentrait à la maison où il n'y avait pas encore de téléviseur.
Son autre passion, vers les années cinquante, était, en période hivernale, le football. Il montait alors à Rocourt pour voir évoluer l'équipe mitraillette du Royal Football Club Liégeois dont il était un ardent supporter. Chaque année, en début de saison il prenait les paris afin de savoir qui serait champion, les « måssis » du Standard ou Liège. Pour lui, pas de problème Liège sera avant le Standard. En ce temps-là, il ne prenait pas beaucoup de risques, car effectivement Liège finissait le championnat devant le Standard. Et Coco, comme de bien entendu recevait ses gains sous la forme de bouquettes de chez Blanche ou des canards à la crème fraîche de chez Herman (ancienne pâtisserie connue de Sainte-Walburge).
En 1951, nous quittâmes la Montagne Sainte-Walburge pour nous installer dans notre nouvelle maison située rue du Limbourg. C'est à ce moment que, grande trahison, les quelques copains de mon père, mordus des deux roues comme lui, sont passés chez l'ennemi à quatre roues. Que voulez-vous, confort et évolution économique obligent. Coco, lui, a fait de la résistance quelque temps en gardant sa précieuse Saroléa. Mais inexorablement, il allait succomber, car ma mère rechignait de plus en plus à grimper sur cet engin de mort, comme elle disait. Il s'est résigné à acheter une voiture. De plus, entre les années 51/55 la grosse moto était un peu en perte de vitesse. Les rutilantes japonaises n'étaient pas encore sur le marché. C'était le temps des petites cylindrées pour la jeune génération. Mon père les appelait les « pétrolettes ». Il n'aimait pas trop travailler sur ces petits engins et quand il devait en essayer une il se sentait ridicule compte tenu de son imposante silhouette.
Il lui restait, bien sûr, les motos de la police à réparer et entretenir. Chaque jour, lorsqu'il revenait à la maison pour dîner, il enfourchait une de ses chères motos. Détail cocasse, pour se protéger, il enfilait ma vieille canadienne à carreaux rouges et noirs que je portais bien des années auparavant lorsque je vendais des petits glaçons canadiens sur la batte.

auquel il ne participera pas...
Au mois de mai, il entrait en transe lorsque débutait le rallye autos/motos de la police gendarmerie. Non pas qu'il participait comme motard, mais comme assistance technique pour l'équipe des jeunes motards de la Police de Liège. Il fallait le voir monter dans le combi Volkswagen suiveur, en salopette, béret vissé sur la tête, coffre à outils en main. Il était heureux, que dis-je aux anges ! Il suivait l'itinéraire des coureurs, s'arrêtait à des points de passage, pour contrôler le fonctionnement des mécaniques, réparant sur la route si nécessaire. Lorsque l'équipe terminait en tête de son groupe, il était satisfait du travail accompli.
Coco est décédé, relativement jeune, à l'âge de 56 ans. C'était en 1966 des suites d'une longue maladie. Déjà malade au mois de mai 66, et, comme d'habitude, il avait mis sa salopette, son béret, pris son coffre à outils pour assister au rallye de la police gendarmerie. Il n'a jamais pu monter dans le combi, très malade ses collègues l'ont ramené à la maison. Il est décédé début juillet.
Il n'a pas eu l'occasion de voir arriver les premières Honda commandées par la Ville de Lège pour remplacer les herstaliennes vieillissantes. Où il se trouve, je suis sûr qu'il doit se sentir bien auprès de ses belles anglaises et ses belles herstaliennes. Moi, je pense aussi qu'une belle geisha ne lui aurait pas déplu, foi de Coco.
Jean de la Marck
